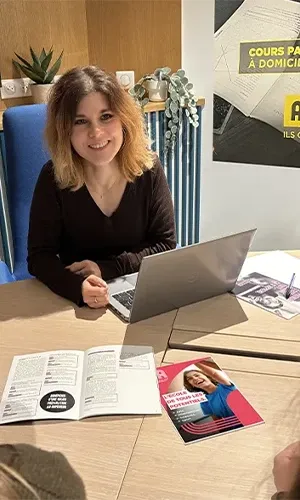Les pléonasmes : la redondance inutile
Le pléonasme consiste à utiliser des termes dont le sens fait double emploi, créant une redondance superflue. Petit tour d’horizon des plus courants :
- Monter en haut : « monter » implique le mouvement vers le haut.
- Prévoir à l’avance : « prévoir » signifie déjà qu’on prend de l’avance.
- Collaborer ensemble : si on est seul, une action commune est-elle possible ?
- Répéter deux fois : « répéter » implique de dire quelque chose deux fois.
- Reculer en arrière : « reculer » veut dire aller vers l’arrière.
- Entrer à l’intérieur et sortir dehors : on vous laisse apprécier…
- Au jour d’aujourd’hui : là, on a une triple redondance entre « jour », « d’ » pour « de » et « aujourd’hui ». Un beau combo qui tourne au barbarisme !
Fait-on le pari qu’à partir du jour d’aujourd’hui, vous prévoirez à l’avance de collaborer ensemble afin de ne pas répéter deux fois ces pléonasmes ? Sans quoi, vous reculeriez en arrière… Blague à part, si jamais ces habitudes vous gênent dans votre quotidien, quelques cours particuliers assortis de bons exercices devraient leur tordre le cou.
Les barbarismes sont tous des déformations de la langue
Les barbarismes sont des erreurs consistant à employer des mots qui n’existent pas ou à déformer des mots existants.
- « Ils croivent » : la conjugaison correcte du verbe croire ici est évidemment « ils croient ».
- « Malgré que » : cette construction incorrecte gagne à être oubliée au profit de « bien que » ou de « même si ».
- « Aller au coiffeur » : on va « chez » le coiffeur.
- « Par contre » : privilégier « en revanche ».
- « Du coup » : actuellement utilisé à tout bout de champ par les plus jeunes, « donc » ou « ainsi » sont d’un bien meilleur effet.
- « Je m’en rappelle de » : la bonne tournure est « Je m’en souviens. »
- « Pallier à » : « pallier » (sans rien après) ou « remédier à ».
- « Aréoport » : une belle déformation phonétique de « aéroport »
- « Il faut fermer la lumière » : on ne la ferme pas, mais on l’éteint.
Les anglicismes : l’influence de l’anglais
Les anglicismes sont des emprunts, souvent inappropriés, à la langue anglaise alors qu’un équivalent français existe. Si bon nombre d’entre eux, à l’instar du « week-end » sont entrés dans le langage courant, l’emploi à outrance de l’anglais est parfois perçu comme abusif.
Petit exemple de phrase entendue au travail : « Je suis busy. Je te call asap pour notre meeting. On débriefera aussi des derniers feedbacks, et on verra si le timing est ok pour la deadline qu’on s’est fixée. D’ici-là, checke tes emails. »
Si on reformule en 100 % français, on pourrait avoir : « Je suis occupé. Je t’appelle dès que possible pour notre réunion. Nous ferons aussi le point sur les derniers retours et verrons si le calendrier convient pour l’échéance que nous nous sommes fixée. D’ici là, consulte tes courriels. »
Cette tournure full french fait peut-être moins fun, allez savoir… Ceci étant dit, le français est une des langues qui a incorporé (et cela continue) le plus de mots étrangers. Les versions amendées des différents dictionnaires en témoignent chaque année.
Les erreurs de grammaire et de conjugaison à déjouer
Les mots « grammaire » et « conjugaison » continuent de faire trembler sur les bancs des écoles. Savoir quelles sont les difficultés majeures permet d’être plus attentif dans sa pratique du français. Une bonne relecture et les assistants orthographiques et grammaticaux dont on peut se doter permettent de limiter des dégâts. Le soutien scolaire en français aussi.
Quelques cas de grammaire à réviser
L’accord des adjectifs qualificatifs pose souvent problème en français. C’est très souvent le cas des couleurs composées, l’expression « ces espèces de coquillages sont bleu clair » reste invariable, contrairement à ce que beaucoup pensent.
La distinction entre « leur » et « leurs » continue de semer la confusion : « Je leur ai donné leurs livres » est la forme correcte, « leur » étant pronom personnel et « leurs », déterminant possessif.
Le mot « tout », quant à lui, s’adapte selon sa fonction grammaticale dans la phrase. Comme déterminant, il s’accorde avec le nom qu’il accompagne. En tant qu’adverbe, il reste invariable devant un adjectif masculin, mais s’accorde au féminin devant une consonne. La prononciation aide à reconnaître sa nature : le « s » de « tous » se prononce uniquement quand il est pronom. Une astuce rapide : remplacer « tout » par « entièrement » permet de repérer sa fonction d’adverbe.
L’usage approprié des prépositions est lui aussi source de confusions. On dit « différent de » et non « différent que », « se souvenir de » au lieu de « se rappeler de ». La confusion entre « à » et « de » est également fréquente : on dit « décider de faire » et non « décider à faire ».
Les adverbes en « -ment » génèrent régulièrement des erreurs. Ils se forment à partir du féminin de l’adjectif : « prudemment » (de prudente), « élégamment » (de élégante). Quant à savoir s’il faut doubler ou pas la consonne, on se pose souvent la question. Et la réponse est : oui !